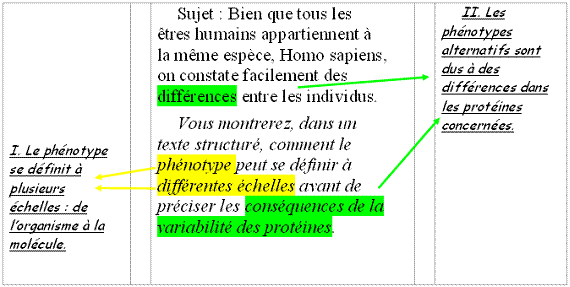Mes conseils de méthode pour le sujet de type I.
Rappel de la définition du sujet :
Partie 1
Cette première partie de l'épreuve, sans document, permet de valider les connaissances acquises par le candidat dans une des sept parties évaluables du programme de l'enseignement obligatoire. La question doit faire apparaître les limites du sujet pour aider le candidat à construire sa réponse , organisée et illustrée par un ou plusieurs schémas dont la nécessité sera formulée. Cette partie est notée sur 8 points.
1° phase : surligner dans le sujet les mots importants aidant à construire la réponse. Ceci permet de trouver les grandes lignes du plan .
|
2° phase : lister les mots clés à utiliser dans chaque partie, réaliser au brouillon les schémas utiles dans le devoir.
introduction :
| même espèce | phénotype | phénotype macroscopique |
I. Le phénotype se définit à plusieurs échelles : de l'organisme à la molécule.
| anémie | capillaire | organisme | cellule |
| molécule | drépanocytose | hématie | hémoglobine |
| désoxygénation | baguettes | phénotype alternatif |
II. Les phénotypes alternatifs sont dus à des différences dans les protéines concernées.
électrophorèse |
charges électriques |
chromatographie |
solubilité |
| 4 chaînes polypeptidiques | chaîne beta | acide aminé | hydrophobe / hydrophile |
| structure primaire | séquence |
conclusion :
| allèles | mutation |

3° phase : regrouper les mots clés pour construire les sous parties (A, B…) dans chaque partie et les questions des transitions.
Comment peut-on expliquer les phénotypes différents des individus ?
I. Le phénotype se définit à plusieurs échelles : de l'organisme à la molécule.
A. Le phénotype macroscopique.
Les différences observées au niveau du phénotype macroscopique existent-elles au niveau cellulaire ?B. Le phénotype cellulaire.
Les différences observées au niveau du phénotype cellulaire existent-elles au niveau moléculaire ?
C. Le phénotype moléculaire.
Comment expliquer cette variation des phénotypes pour un même caractère ?II. Les phénotypes alternatifs sont dus à des différences dans les protéines concernées.
Comment distingue-t-on les protéines différentes ?
A. Technique d'étude des protéines : Cas de l'hémoglobine.
1) L'électrophorèse.
2) La chromatographie.
Quels sont les liens de cause et conséquence entre les différents niveaux de phénotype ?
B. Liens entre les 3 niveaux du phénotype.
4° phase : rédiger l'introduction (amorce comportant le problème à résoudre puis annonce du plan) et la conclusion (résumé puis élargissement) au brouillon.
Introduction :
Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce car ils peuvent se reproduire entre eux et ils possèdent tous les caractères communs qui définissent l'espèce humaine : des cheveux, des yeux, un nez, des bras, des jambes…, mais aussi un groupe sanguin, des hématies contenant de l'hémoglobine…
Bien qu'étant identiques, ces êtres vivants sont différents entre eux. Ainsi, on observe des variations individuelles pour chaque caractère (couleur des cheveux, groupe sanguin, couleurs des yeux…).
L'ensemble des caractères qui participent directement à la construction et au fonctionnement de chaque organisme constitue le phénotype .
Comment peut-on expliquer les phénotypes différents des individus ?
Nous résoudrons ce problème en étudiant dans un premier temps les différents niveaux de phénotype avant de nous pencher sur les différences protéiques à l'origine des phénotypes alternatifs.
Conclusion :
Pour un caractère donné, les phénotypes s'expriment à plusieurs niveaux : macroscopique, cellulaire et moléculaire. En général il existe plusieurs phénotypes qualifiés de phénotypes alternatifs pour un caractère donné. Puisque les protéines sont le support moléculaire de la réalisation des phénotypes, il semble logique que des phénotypes alternatifs soient dus à des différences dans les protéines concernées.
La globine bêta de l'hémoglobine est une protéine : comme toute protéine, elle est le produit de l'expression d'un gène. Or on sait que la séquence de nucléotides du gène détermine la séquence d'acides aminés de la protéine. Comment le génotype détermine le phénotype moléculaire ?
5° phase : rédiger le devoir sur la copie. Il est inutile de tout écrire au brouillon.